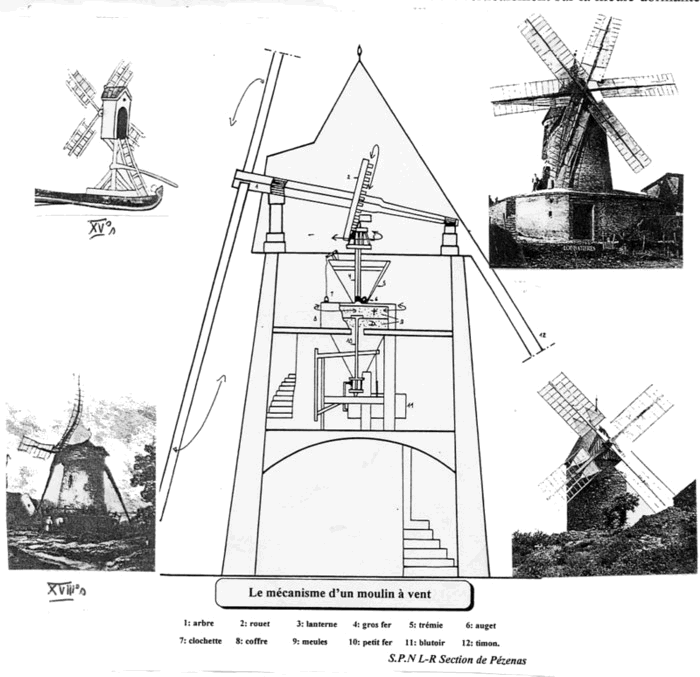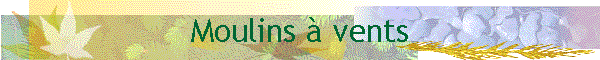
Quelques
éléments historiques:
La technique de transformation de l’énergie éolienne en force de travail a été développée en Bas-Languedoc durant le XIIIème siècle. Auparavant d’autres sources d’énergie avaient successivement été utilisées dans l’entreprise de moulure des grains. Au broyage manuel pratiqué depuis le néolithique a succédé le broyage par meules mues par traction animale puis, durant l’antiquité, par la transformation de l’énergie hydraulique.
Dès le IXème siècle, la technique de la meunerie hydraulique héritée des savoir-faire de l’antiquité se développe sur tous les cours d’eau de la région. Le milieu du XIIème voit l’apogée de cette technologie qui restera largement majoritaire jusqu’au début du XXème siècle. Parallèlement à la meunerie hydraulique les premiers moulins à vent apparaissent timidement dans nos archives durant le premier tiers du XIIIème siècle. C’est dans les zones de garrigue ainsi que sur les plateaux balayés par les vents régionaux que se développent ces moulins. Toutefois la meunerie éolienne restera minoritaire. Au maximum de son expansion, courant XVIIIème siècle le territoire correspondant au département de l’Hérault comprend quelques 61 moulins à vent contre 349 à eau. Le problème majeur qui pénalise la meunerie éolienne réside dans la rentabilité de cette technique:
Dans une tour de 6 mètres à la base un seul jeu de meules pouvait être installé et mis en fonctionnement. Le rendement moyen d’un moulin à vent s’élevait à 400kG de mouture par jour. Dans le même temps, les plus gros moulins de la région, tel celui d’Agde pouvait, grâce à l’énergie hydraulique, mettre en mouvement 7 jeux de meules. De plus, la réputation de la qualité de la mouture obtenue par la technique éolienne a de toujours été décriée, un handicap d’image.
Il n’en reste pas moins vrai que les moulins à vent ont broyé les grains et les olives, mus par les vents de terre ( le terral ) et les vents marins sept siècles durant. Ils ont permis le développement de communautés agricoles dans des secteurs où l’énergie hydraulique ne pouvait assurer la transformation des productions de grains. Ils ont été également implantés dans des secteurs où le vent permît l’utilisation complémentaire de cette autre force naturelle alors que les moulins à eau saturaient la capacité des rivières. Le cas de Magalas illustre bien ce fait. Dans cette communauté on dénombre la coexistence de trois moulins à huile dans les murs de la ville, de 8 moulins à blés hydrauliques sur le Libron et la Lène et de trois moulins à blé éoliens sur les collines. Sur le territoire de Pouzolles-Margon, la carte Ign permet de localiser 2 moulins à vent.
La dernière meule mue par le vent a cessé de tourner vers 1903. Aux problèmes de rendement se sont ajoutés deux phénomènes pérennes: L’abandon des cultures vivrières au profit de la viticulture de masse a épuisé les ressources en grains régionales. Les moulins à eau, plus rentables ont alors mieux résisté à la concurrence. Pour se faire une idée de la mutation agricole qu’ont dû subir les meuniers il semble utile de relever des chiffres de statistiques agricoles du Canton de Roujan. En 1820, le canton possédait 6 295 hectares de terres agricoles. 50% de ces terres étaient cultivées en grains ( blés, seigle, orge et avoine ) alors que la superficie des vignes ne représentait que 35 % de l’espace agricole. La culture des oliviers était localisée et représentait moins de 5%. Cette mutation agricole n’a pu s’opérer que dans un nouveau contexte où le Bas -Languedoc a pu s’approvisionner en denrées alimentaires. Le développement des moyens de transport assurait l’approvisionnement du marché languedocien en des farines produites à plus faible coût dans le Sud-Ouest ainsi qu’en huiles venues d’Espagne et d’Italie. Le cumul des handicaps a fini de perdre la meunerie éolienne déjà réduite à 5 moulins depuis le milieu du XIXème siècle.
Les derniers moulins à eau survivront jusqu’au milieu du XXème siècle. La meunerie à vapeur n’a fait qu’une brève apparition entre 1893 et 1920, période durant laquelle quelques 6 moulins de ce type ont été recensés.
Jérôme Ivorra
Quelques
éléments techniques:
L’architecture type du moulin bladier ( à blé ) à vent développé en Languedoc fût caractérisée par un bâtiment cylindrique bâti en pierre et coiffé d’une tourelle conique de bois qui abritait le mécanisme de transformation de l’énergie éolienne en travail mécanique. La tourelle pouvait pivoter afin d’orienter les ailes de bois recouvertes de tissus selon la direction du vent. Afin de protéger la fragile machinerie, la vitesse de rotation des ailes pouvait être régulée grâce à un système de freinage. Le meunier versait le grain dans la trémie ( 5) par l’auget (6 ) encore nommé esclop. Le grain s’écoulait dans l’œillard de la meule. La force centrifuge permettait à la mouture d’être évacuée via les sillons creusés sur les meules( 9 ).La mouture était collectée au premier étage dans le blutoir ( 11 ) où, par vibration, des tamis séparaient la farine du son.
Dans un moulin à blé la meule tournante tourne sur la meule dormante sur un plan horizontal, tandis que dans le cas des moulins à huile la tournante est mise en mouvement verticalement sur la meule dormante afin de parvenir à écraser la coque des noyaux et de libérer l’huile.